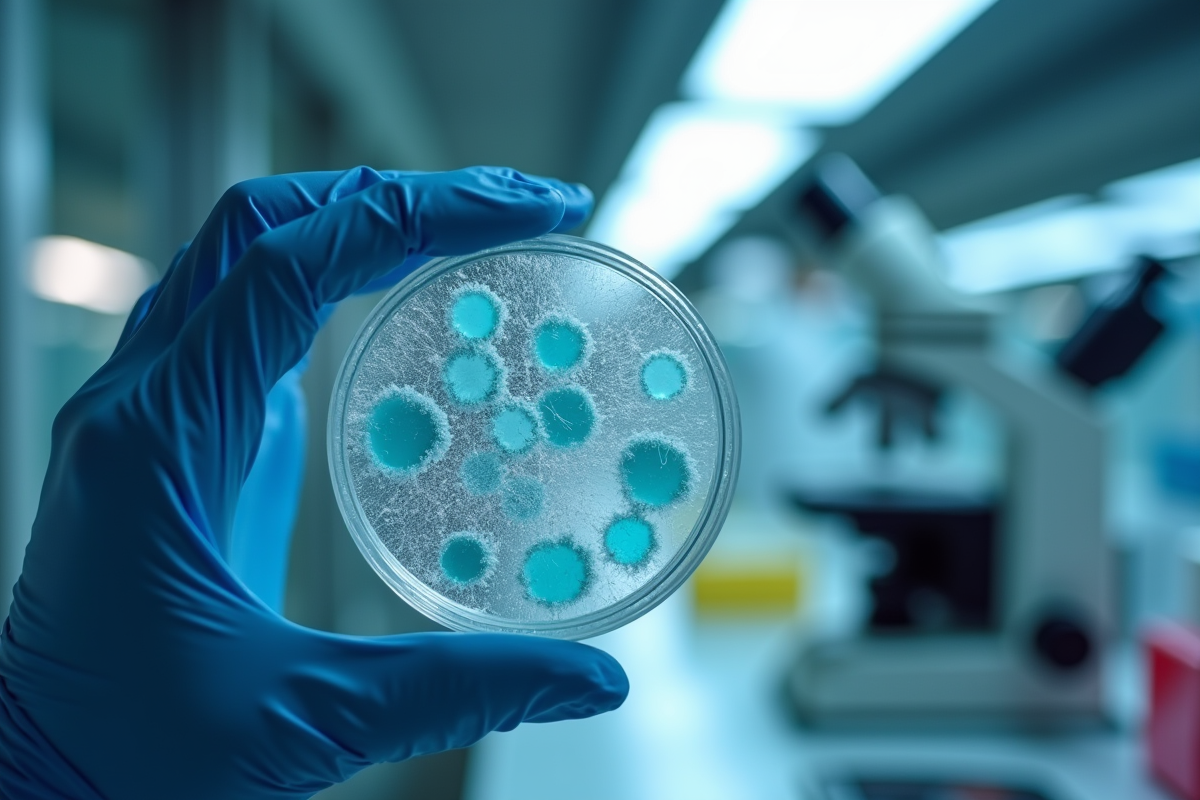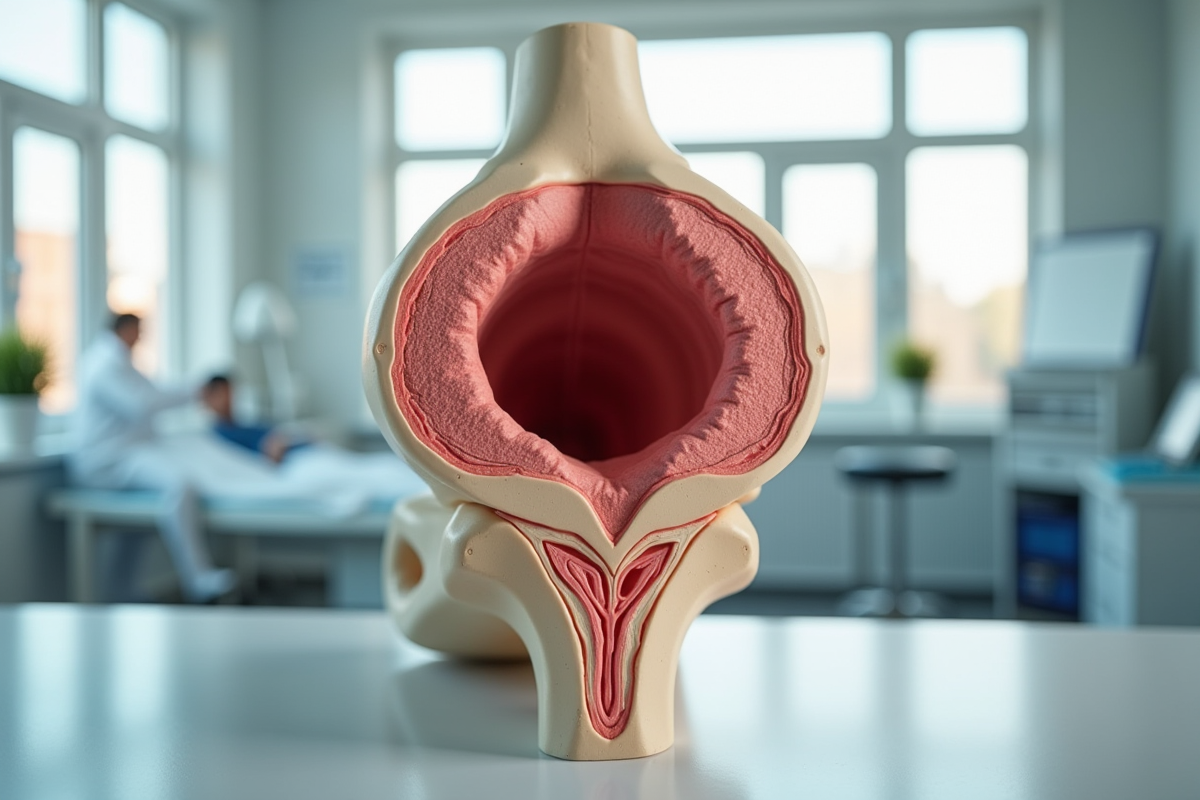Un tissu adulte conserve une réserve cellulaire capable de générer plusieurs types de cellules spécialisées, malgré l’arrêt du développement embryonnaire. Certaines cellules rares persistent dans des niches spécifiques, à l’abri de la différenciation terminale.
Leur présence varie selon l’organe, la maturité biologique, ou même le contexte pathologique. Des protocoles distincts sont requis pour leur isolement, selon leur localisation et leur potentiel.
Cellules souches : des origines multiples et des rôles essentiels
Au commencement, tout part d’une cellule unique. Cette cellule fécondée, totipotente, détient le pouvoir de donner naissance à un organisme entier, annexes embryonnaires comprises. Mais, très vite, le champ des possibles se resserre : dès le stade du blastocyste, entre le cinquième et le septième jour après une fécondation in vitro, la masse cellulaire interne révèle les toutes premières cellules souches embryonnaires. Celles-ci, qualifiées de pluripotentes, bâtissent l’ensemble des tissus de l’organisme, à l’exception des annexes.
Deux capacités les distinguent : auto-renouvellement et différenciation. Par division symétrique, elles alimentent leur propre réserve ; par division asymétrique, elles donnent le signal de départ vers la spécialisation. À ce jeu, la cellule souche multipotente limite son potentiel à un seul feuillet embryonnaire. Prenez la cellule souche hématopoïétique : elle engendre globules rouges, blancs et plaquettes, mais jamais neurone ou hépatocyte.
L’irruption des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) a ouvert une brèche. Grâce à la reprogrammation de cellules adultes déjà différenciées, la recherche biomédicale dispose d’un outil flexible, qui s’affranchit de nombreux blocages éthiques. Ces iPSC, proches cousines des souches embryonnaires, ont bouleversé les stratégies de modélisation des maladies et de développement de nouveaux traitements.
À chaque tissu, son rythme : la quiescence maintient certaines cellules souches en sommeil, prêtes à entrer en scène à la moindre lésion. La sénescence les pousse, au contraire, vers la sortie. Avec l’âge, ce réservoir se tarit, ce qui réduit la capacité des tissus à se régénérer ou à maintenir leur équilibre.
Où se trouvent les principales sources de cellules souches dans l’organisme ?
Chez l’adulte, la moelle osseuse tient la vedette. Véritable sanctuaire des cellules souches hématopoïétiques (CSH), elle assure le renouvellement continu du sang et joue un rôle déterminant dans de nombreux protocoles de greffe ou de traitement de maladies du sang. Mais la moelle osseuse n’est pas la seule à abriter ces pépites cellulaires : le sang de cordon ombilical en recèle également, sous une forme moins mature. Recueilli à la naissance, ce sang est devenu un atout majeur, notamment pour les jeunes patients en attente de greffe.
Un autre type, la cellule souche mésenchymateuse, sait se faire remarquer par sa plasticité. On la repère dans la moelle osseuse, mais aussi dans le tissu adipeux, où elle s’isole plus facilement. Capable de se différencier en os, cartilage ou tissus conjonctifs, elle suscite l’intérêt pour la réparation osseuse et l’ingénierie tissulaire.
D’autres niches, parfois moins connues, hébergent leur propre réserve. L’épiderme se régénère en continu grâce à ses cellules souches basales. L’intestin, champion du renouvellement cellulaire, s’appuie sur des cellules marquées par Lgr5, nichées à la base des cryptes, sous la protection des cellules de Paneth. Même le cerveau, longtemps considéré comme incapable de renouvellement, recèle des cellules souches dans la zone sous-ventriculaire et l’hippocampe.
Chaque niche de cellule souche s’entoure de véritables sentinelles : cellules stromales, cellules de Paneth, facteurs locaux… Tous orchestrent l’équilibre délicat entre repos, prolifération et spécialisation.
Applications actuelles et perspectives de la recherche sur les cellules souches
Les cellules souches ont bouleversé la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Les greffes de cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang de cordon ombilical sont déjà utilisées pour traiter des leucémies et certaines pathologies du sang. Ces approches parviennent à restaurer des lignées entières de cellules, parfois après avoir éliminé toute la moelle défaillante.
Mais le champ d’action grandit avec les cellules souches embryonnaires et les cellules pluripotentes induites (iPSC). Grâce à la reprogrammation de cellules adultes, on peut désormais modéliser des maladies rares, tester de nouvelles molécules, ou imaginer des traitements sur mesure. Des essais cliniques sont en cours pour la DMLA, le diabète de type 1 ou la drépanocytose. Les iPSC, contrairement aux souches embryonnaires humaines, évitent le recours à des embryons, ce qui lève de nombreux obstacles éthiques.
Aujourd’hui, la maîtrise de la différenciation des cellules souches et de leur plasticité mobilise de vastes équipes de chercheurs. Des outils puissants comme CRISPR/Cas9 permettent d’envisager une correction génétique ciblée : modifier une mutation responsable d’une maladie grave, puis réinjecter les cellules corrigées, devient une perspective concrète.
En France, l’Inserm et l’institut I-STEM multiplient les avancées sur les facteurs de croissance, l’étude du sécrétome, ou la régulation par Notch et Wnt. Les protocoles font l’objet d’un encadrement strict par l’Agence de la biomédecine et le comité consultatif national d’éthique, surtout pour l’utilisation de cellules souches embryonnaires provenant d’embryons surnuméraires, sous réserve du consentement parental.
À mesure que la science défriche le territoire des cellules souches, le vivant dévoile ses ressources cachées. La marge de progression laisse entrevoir des horizons où la réparation de l’organisme ne relèverait plus du rêve, mais d’une réalité façonnée cellule par cellule.